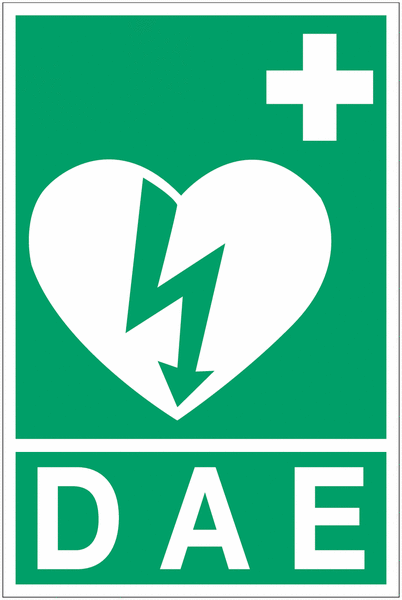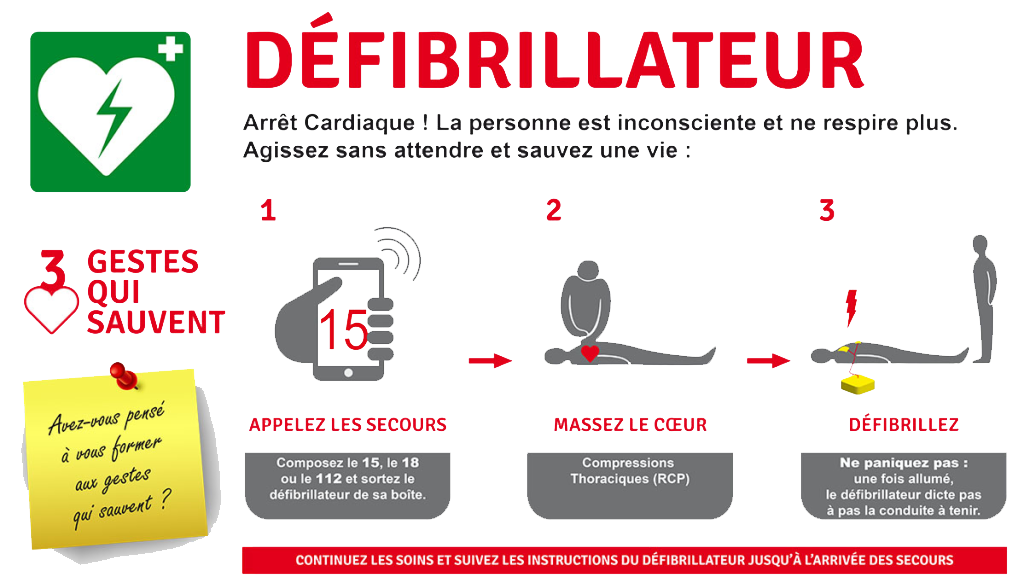HISTOIRE ET MONUMENTS, LIEUX DE VISITE ET DE DECOUVERTES
(Cliquer sur les images pour les agrandir)
- Présentation de la Rouaudière
- Les Armoiries de la Rouaudière
- Histoire des Blasons de la Mayenne
- Quelques Seigneurs de la Rouaudière
- Quelques seigneurs de la Huberderie
- Les maires de la Rouaudière à travers l’histoire
- L'Architecture
- La Chapelle Notre Dame De Toutes Aides
- Le Chêne de Notre Dame De La Chauvière
- Plaque commémorative de l’Abbé Alexandre Denis Girardot
Canton de Saint-Aignan-sur-Roë
Arrondissement de Château-Gontier
Superficie : 1 900 ha
Habitants : les Roalderiens
Cours d’eau : le Chéran
Anciens Noms de la Rouaudière :
- Ecclesia que Roalderia dicitur, 1136 (Cart. de la Roë, f. 23).
- Sancta Maria de Roalderia, 1136 (Ibid., f. 6).
- Prior de la Renaudière, 1398 (Arch. nat., X/1a. 45, f. 168).
- Prieuré de la Rouaudière, 1414 (Ibid., P. 338).
- Le bourg de la Rouaudière, 1450 (Arch. de M.-et-L., Pouancé).
- La Rouauldière, 1480 (Dict. topog.).
- La Rovaudière (Jaillot).
- Les Trois-Maries de la Rouaudière, 1758.
Les Armoiries de la Rouaudière :
Deux grandes familles sont représentées à la Rouaudière.
Les seigneurs de la Jaille
Seigneur de la Rouaudière et de la Huberdière au début du 13e siècle.
Les seigneurs Jacquelot
Seigneur de la Rouaudière et de Saultray, fin du 15e siècle.
Il fallut choisir laquelle de ces deux familles allait représenter la Rouaudière.
Des recherches ont été nécessaires auprès des Archives de la Mayenne, ceux-ci nous ont indiqué que seules les armes d’une famille éteinte peuvent être relevées par une commune. Il est en effet interdit d’usurper des armes existantes et, si la famille est encore représentée, toute réutilisation de ses armes serait assimilée à une usurpation.
Enfin, et c’est le plus important, nous ne pouvons doter la commune d’un nouveau blason si elle en a déjà un.
Après vérification dans l’Armorial monumental de la Mayenne de l’abbé Angot, il n’y a qu’une seule référence pour La Rouaudière (p. 363), et elle n’est pas pertinente. En revanche, le syndicat d'initiative du canton de Saint-Aignan-sur-Roë a publié chez Raynard, en 1989, un fascicule intitulé Nos blasons et leur histoire, compilé par Antoinette Homps. On y trouve p. 12 le blason de La Rouaudière, issu de celui de la famille de La Jaille. Il est d’or, à la bande fuselée de gueules, c’est-à-dire à fond doré surmonté d’une bande oblique de losanges rouges.
C’est donc les Armoiries de la famille de la Jaille qui représentent aujourd’hui la Rouaudière.
HISTORIQUE DES BLASONS DE LA MAYENNE
Le blason de la Rouaudière : page 17 & 18
Une occupation est attestée dès le Néolithique grâce à un ensemble mobilier ( Hache, Hache marteau ) mis au jour sur son territoire. La commune se situe dans la vallée du Chéran qui prend sa source dans le bois d'Andigné. La cartographie des mégalithes et la toponymie permettent de déterminer un axe protohistorique.
HACHE MARTEAU
Néolithique
Collection particulière
 Cette hache marteau cordiforme est découverte en 1976 à la ferme de Beauvais. La fonction de ces objets est encore aujourd'huiindéterminée.Ils se présentent généralement en forme de cœur avec, de part et d’autre de l'emmanchement, un talon et un tranchant. La datation n'est pas établie, mais il semblerait que ces haches aient été utilisées à la fin du Néolithique. La plus grande densité de ces outils se manifeste en Haute Bretagne. Cependant, une concentration non négligeable est constatée au sud-ouest de la Mayenne, sur la frontière entre l'Anjou et la Bretagne.
Cette hache marteau cordiforme est découverte en 1976 à la ferme de Beauvais. La fonction de ces objets est encore aujourd'huiindéterminée.Ils se présentent généralement en forme de cœur avec, de part et d’autre de l'emmanchement, un talon et un tranchant. La datation n'est pas établie, mais il semblerait que ces haches aient été utilisées à la fin du Néolithique. La plus grande densité de ces outils se manifeste en Haute Bretagne. Cependant, une concentration non négligeable est constatée au sud-ouest de la Mayenne, sur la frontière entre l'Anjou et la Bretagne.
MEULE
120 av. J.-C.-50 av. J.-C.
Granit (d : 35 cm)
La meule rotative est apparue à La Tène finale.
Elle est constituée de deux éléments dont la partie supérieure, le catilus, peut tourner grâce à une poignée en bois emmanchée sur le côté. Ce fragment de la partie dormante, appelé meta, de 35 centimètres de diamètre, est mis au jour en 1988 dans un fossé bordant un champ aux environs de la ferme des Blanchardières. Cette découverte est la seconde du canton. L'existence de cet outil atteste que les agriculteurs protohistoriques produisaient des céréales.
Cadran Solaire
Ce cadran solaire est daté de 1637….
En 1136, La Rouaudière (Roalderia) était un prieuré-curé dépendant de l'abbaye de la Roë et mentionné dans l'acte 45 du cartulaire de l'abbaye Notre-Dame-de-La-Roë sur lequel est mentionné la donation par Griferius de Congreio (Congrier) de l'église à Robert de Monte-nazé, abbé de La Roé.
La Rouaudière dépend de la baronnie de Pouancé.
Sous l'Ancien Régime, la paroisse de La Rouaudière est rattachée à la baronnie angevine de Craon, qui elle-même dépendait de la sénéchaussée principale d'Angers et du pays d'élection de Château-Gontier.
À l’époque de la féodalité, un château fort existait ou se trouve maintenant le bourg de La Rouaudière. Ce vieux château fut le noyau autour duquel se forma la paroisse. Son existence n’est pas douteuse ; les restes de l’antique chapelle féodale, détruit seulement en 1842, en sont la preuve. La métairie de la cour, bâtie si près de l’église, atteste bien par son nom, qu’elle était la métairie de la cour du château.
L’ancien château était défendu par de grandes douves qui en interdisaient l’entrée. Ces douves ont été comblées. Il y avait également des souterrains dont le dernier a été comblé aux alentours de 1880. Monsieur Cholet, curé de La Rouaudière de 1857 à 1895 écrits en effet dans ses mémoires : « le dernier souterrain a été détruit, comblé et bouché sous mes yeux. »
Au 17e siècle, après la destruction de leur château - dont des vestiges étaient encore visibles en 1850 -, situé près de l'église, les seigneurs établirent leur siège à La Huberderie.
La seconde maison seigneuriale est Le Tais dont les propriétaires portent jusqu'au 20e siècle. En 1843, le fief de Vildé est rendu à La Rouaudière qui abandonne notamment La Chevronnais, Les Renardières, le moulin à la commune de Congrier et à Saint-Aignan-sur-Roé tout le terrain à partir du pont de l'étang de la Chevronnais jusqu'aux moulins des Fossettes et au village de La Primais.
Des briques sont fabriquées jusqu'à la fin du 19e siècle au lieu-dit le Four-à-Carreaux.
Quelques Seigneurs de la Rouaudière :
- Lisois de la Rouaudière, 1136.
- Gestin de la Jaille, Seigneur de la Rouaudiere et de la Huberdière, 1208
- Raoul de la Jaille, 1232
- Briand de la Jaille, 1353
- Estor de la Jaille, 1453.
- Louis de la Jaille, 1494.
- Philippe Jacquelot, seigneur de Saultray
- Louis Jacquelot , 1621
- Philippe Jacquelot achète la seigneurie de la Rouaudière en 1631.
Quelques seigneurs de la Huberderie :
- Louis de la Jaille, 1594
- Bertrand Beu,
- Jacquelot de la Huberderie, 1627
- Jacques Pantin ( marié à Louise Jacquelot )
- Jean Pantin, seigneur de la Rouaudière, 1713
- M. de Saint-Moran, 1766.
- M. de la Chevière
Les maires de la Rouaudière à travers l’histoire :
M. Jean JULIOT, 1791
M. Mathurin PIPARD, janvier 1793.
La municipalité est désorganisée, an IV.
M. Jacques DOUDET, 1798.
M. JULIOT fils, juin 1799.
M. Paul PAILLARD (démissionne), 1800.
M. Jean-Joseph BOUCHER, 1800, 1813.
M. Louis LETORT de la Chevrolais, 1813, 1815.
M. Paul PAILLARD, 1815, 1827.
M. Jean PECOT, 1829, 1836.
M. Pierre BLANCHARD, 1837.
M. Jean VIVIEN, 1840, 1843.
M. Jacques LORIER, 1850, 1852.
M. Jean DOINEAU, 1855, 1892.
M. Louis SALLIOT, 1892
M. Paul VIVIEN, 1945 à 1995
Mme Elisabeth DOINEAU, 1995 à 2008
M. Patrice BOISSEAU, 2008 à mars 2014
M. Philippe HEUZE, 2014 au 18 mai 2020
M. Thierry JULIOT, Depuis le 18 mai 2020
Architecture :
15e et 17e siècles
La congrégation des Génovefains de La Roë, a fondé des prieurés dans certaines agglomérations gravitant autour de l'abbaye. En 1135, le pape Innocent II confirme la donation du prieuré curé de La Rouaudière aux chanoines de La Roë. En 1450, le prieur Jacques Cheminard convient avec celui de La Madeleine-de-Pouancé, qu'il aura la présentation tandis que ce dernier aura la collation de « maistrerie » d'école. Le 27 mars
1783, l'abbé Girardot (exécuté pendant la Révolution) prend possession des lieux, par devant Me Cheneau, notaire royal apostolique de la ville d'Angers : il en sera le dernier prieur-curé.
Le prieuré, vendu pendant la Révolution, fut racheté par M.Gautier, curé, et revendu ensuite à M. Vivien.
À la fin du 19e siècle, un bâtiment attenant est construit d'après les plans de M. Foubert, architecte à Sillé-le-Guillaume. Le nouveau presbytère est achevé et livré au clergé le 1er octobre 1897. De nos jours, transforme en gite d’étape, et connu sous le nom de manoir, il peut héberger jusqu'à 19 personnes.
La Huberderie
La Huberderie fut fondée par le curé Jacquelot le 27 novembre 1623
Après la destruction de leur château au 17e siècle, les seigneurs de La Rouaudière établissent le siège de leur seigneurie à la Huberderie.
Les seigneurs de la Huberderie possèdent aussi le fief de Vildé. Ce dernier est alors une enclave dépendant de la commune de Congrier. Monsieur Letort, ancien employé supérieur des fermes du Roi à la baronnie de Pouancé, fait l'acquisition du fief de Vildé au 17e siècle. La chapelle Saint Louis est fondée par le curé Louis Houillot en 1627. Le logis possède une tour toujours à un angle qui a semble-t-il servi de petit colombier.
Le Manoir De La BLOTTAIS (tour) 
17e siècle
La Blottais
Ce manoir a gardé sa tourelle d'origine. Au début du 19e siècle, il est la propriété de la famille de La Blotais, issue du Maine et Loire. Armand de La Blotais est maire de Gesté dans le canton de Beaupreau, du 2 août 1816 jusqu'en 1830. Fortuné de La Blotais est maire de cette même commune de 1870 à 1908. Le manoir est, de nos jours, la résidence principale d'exploitants agricoles.
La Chapelle NOTRE DAME DE TOUTES AIDES 
1730
Cette chapelle est située dans un champ près de la ferme de La Grossière. Elle est aussi connue sous le vocable de Notre-Damede-Bon-Secours. Elle doit sa construction à l'église paroissiale. En effet, cette dernière est primitivement consacrée à la Vierge Marie, puis en 1606, elle passe sous le patronage des Trois-Marie. Certains paroissiens protestent et décident de construire, à leurs frais, cette chapelle dédiée à la sainte Vierge, sur un terrain donné par le seigneur de la Huberderie. Le 18 juin 1730, deux mille personnes assistent à la bénédiction de l'édifice et de la statue Notre-Dame-de-Toutes-Aides.
La fête annuelle est fixée le jour de la Visitation. Sa fréquentation est importante devant l'infinité de guérisons et de consolations attribuées à son intercession. À la fin du 19e siècle, des travaux sont entrepris : la chapelle est rallongée et un clocheton est apposé. La cloche du presbytère y est installée, à titre provisoire, pour permettre de sonner les offices.
L'autel date de juin 1897. Le 15 août de cette même année, l'ancienne procession est rétablie, et rassemble plus de cinq cents personnes.
Le Chêne De NOTRE DAME DE LA CHAUVIÈRE
L'origine de la vénération du chêne de Notre Dame de La Chauvière n'est pas parvenue jusqu'à nous.
Il est parfois désigné comme le lieu où un prêtre insermenté aurait célébré le Saint Sacrifice de la messe pendant la Révolution.
Au 19e siècle, une boite en bois abritant, une statue de la Vierge est accrochée au tronc. En 1897, le chêne 
étantsur un terrain communal, le curé demande au maire, M. Saillot, l'autorisation d'entreprendre des travaux en raison du mauvais état de la boîte servant de chapelle.
Le prêtre décide alors d'entreprendre de creuser le tronc afin d'y établir une chapelle intérieure. Cette tâche est réalisée en quinze jours par le charron et le maréchal ferrant, une semaine avant l'Assomption. Des exvoto sont accrochés au tronc en remerciements des grâces accordées par Notre Dame.
1842-1843
L'église a été saccagée pendant la Révolution.
Une nouvelle église au style ogival a été bâtie à la place en 1842.
Comme beaucoup d’églises de campagne, celle de la Rouaudière n’est ouverte que pour certaines cérémonies. Elle a subi, de plus, les outrages du temps.
Cependant, elle mérite qu’on s’y attarde un peu. Reconstruite entre le 14 avril 1842 et le 8 septembre 1843 à l'emplacement de l'ancienne église dédiée aux Trois-Marie 1606, d'après les plans de Maximilien Godefroy, architecte ayant exercé un temps aux États-Unis, elle est un des premiers exemples en Mayenne de la redécouverte du style gothique. Moderne à l’époque par son architecture, elle reste traditionnelle par son ameublement : son chœur, orné d’un très grand retable, est inspiré des modèles lavallois du 17e siècle.
Elle conserve un ensemble intéressant de statut du milieu du XIXe siècle, réalisée par les sculpteurs Barême et Barré (angevin et rennais), et des tableaux du 17e et 19e siècle.
Le maître autel est l'œuvre de Monsieur Baudier d'Évron.
Église des Trois-Maries
Cette plaque rappelle le souvenir de l'abbé Alexandre Denis Girardot, ancien curé de la Rouaudière, prêtre martyr, fusillé à Craon, le 17 mars 1796.
Alexandre Denis Girardot naquit à Cumières, diocèse de Reims le 17 avril 1740.
Le jeune homme se sentit très tôt appelé à la vie monastique et entra dans l’ordre des chanoines réguliers de la congrégation de France.
Les religieux de cet ordre dirigeaient alors le grand séminaire de Reims.
Le 27 mars 1783, il prend possession du prieuré curé de La Rouaudière où ses supérieurs l’avaient envoyé.
Bientôt l’orage révolutionnaire éclata, Mgr Girardot, sur son refus de prêter serment à la constitution fut interné à la prison des cordeliers à Laval le 20 juin 1792.
Il fut ensuite déporté en Angleterre et revint à La Rouaudière en mars 1795.
À partir de cette date il assure son ministère avec un dévouement héroïque, risquant sa vie à chaque instant. Plusieurs familles chrétiennes de La Rouaudière lui donnaient secrètement asile. On cite en particulier les demoiselles Delanoé.
Mgr Girardot connaissait aussi les cachettes de la Huberderie, qui souvent lui servait de refuge.
À la fin de l’année 1795, après une brève accalmie, les massacres recommencèrent. La lutte fut acharnée dans nos régions ou royalistes et bleus s’entre-déchirèrent. Mgr Girardot se cacha de nouveau et ne voulut pas abandonner ses ouailles. Sa présence était tenue secrète. Le 16 mars 1796, Mgr Girardot était occupé à entendre les confessions quand d’un coup, on vint l’avertir que la garde de Craon venait faire une battue à La Rouaudière et on le pressait de s’éloigner. Trahi par un royaliste en qui il avait toute confiance, Mgr Girardot est arrêté alors qu’il s’était réfugié chez les demoiselles Delanoé. Il fut emmené, sous bonne escorte à Craon où il fut jeté en prison. La sentence de mort ne se fit pas attendre. Dès le lendemain de son arrestation, 17 mars 1796, Mgr Girardot fut conduit en dehors de la ville pour être fusillé. Son corps fut enterré à l’endroit où il avait été fusillé et y demeura jusqu’en 1822.
En cette année, une mission fut prêchée à Craon par les jésuites de Laval. Ceci ayant appris les détails de la mort de Mgr Girardot firent rechercher ses restes et les enfermèrent dans une caisse en bois. Les habitants de La Rouaudière reçurent avec joie les ossements du bras du saint prêtre.
Accompagné d’un missionnaire, ils remportèrent la précieuse relique et la placèrent dans le sanctuaire de leur église, enfermée dans le mur non loin du maître-autel ou une plaque commémorative fut apposée.